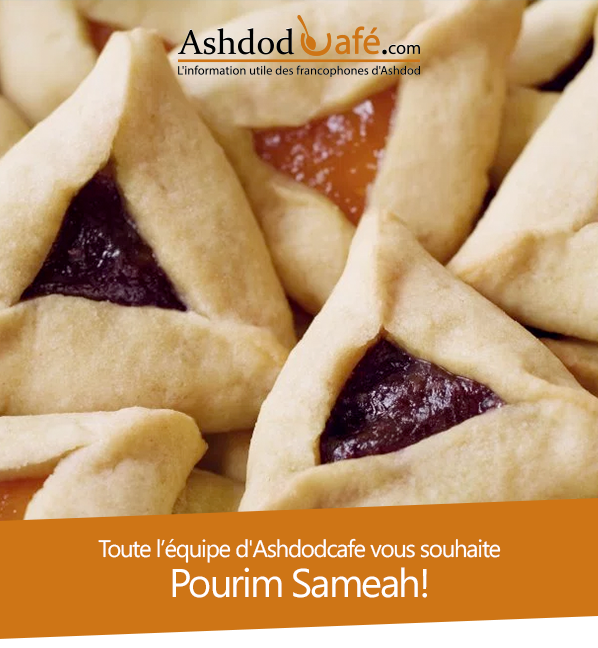Israël traverse aujourd’hui un temps de fracture. Deux radicalités s’affrontent, comme deux miroirs inversés qui, loin de se contredire, se nourrissent l’une l’autre. D’un côté, l’orthodoxie religieuse, barricadée dans une citadelle de lois et de coutumes, refusant la souveraineté politique au nom d’un absolutisme spirituel, se replie sur un légalisme desséché, qui transforme la Torah en une forteresse de règles plutôt qu’en souffle de vie.
De l’autre côté, la gauche radicale, héritière du messianisme sécularisé et du rêve révolutionnaire européen, s’évertue à dissoudre l’identité hébraïque dans un universalisme abstrait, souvent hostile, qui n’est que le miroir inversé de l’enfermement religieux. Ces deux camps se combattent avec acharnement, mais ils procèdent d’une même racine : l’histoire ashkénaze, forgée dans le ghetto, façonnée par les pogroms, hantée à la fois par l’obsession de la pureté et par le désir d’émancipation totale.
L’Europe de l’Est a façonné une mentalité du « tout ou rien ». La violence des persécutions répétées a conduit certains à se barricader dans une fidélité sans compromis, convaincus que seule une forteresse halakhique pouvait sauver ce qui restait d’Israël. Ainsi naquirent les yeshivot de Lituanie, les dynasties hassidiques de Galicie, où le monde se divisait en deux : l’intérieur, pur et protégé, et l’extérieur, menaçant et corrompu. D’autres, au contraire, ont rompu avec la tradition, projetant leur énergie vers un avenir de rédemption terrestre. Le Bund, le marxisme, le trotskisme, Rosa Luxemburg, Trotski, Freud et Marx : autant de figures où l’esprit dialectique juif, formé par des siècles de Talmud et de polémique, se transféra dans un projet universel d’émancipation totale. Comme l’avait déjà pressenti Gershom Scholem, la mystique juive et l’utopie révolutionnaire partagent une même structure cachée : une attente messianique, une impatience de la fin, une volonté d’abolir le monde tel qu’il est pour précipiter l’avènement d’un monde nouveau. C’est le même schéma, seulement déplacé du champ religieux au champ politique.
Mais ce radicalisme n’est pas l’unique visage du judaïsme. L’autre moitié de notre histoire, la moitié sépharade, a suivi un chemin différent, plus discret peut-être, mais plus fécond pour l’avenir. Les juifs d’Andalousie, du Maghreb, de l’Empire ottoman n’ont pas connu le ghetto fermé comme en Pologne. Ils vécurent sous le statut de dhimmi, certes inférieurs en droits, mais insérés dans le tissu social, économique et culturel de leurs environnements. Ils développèrent alors une culture de synthèse, où le judaïsme ne s’opposait pas au monde extérieur mais dialoguait avec lui. Maïmonide au Caire sut unir Aristote et la Torah, écrivant son Guide des égarés dans un arabe philosophique aussi raffiné que son hébreu halakhique. Yosef Karo, à Safed, composa le Choulhan Aroukh en intégrant la pluralité des coutumes du monde juif, donnant ainsi au peuple un code qui n’était pas l’expression d’une secte, mais l’effort pour l’unité. Cette tradition sépharade se caractérise par une sagesse d’équilibre : ne pas rejeter la vérité étrangère, mais l’accueillir, l’intégrer et la féconder. Comme l’écrit Maïmonide : « Accueille la vérité d’où qu’elle vienne » (Guide des égarés I, 71). Ce n’est pas une simple maxime intellectuelle, mais un programme de civilisation.
Là où l’histoire ashkénaze a souvent produit des réponses extrêmes, l’histoire sépharade a cultivé la patience et la nuance. Sa religiosité était empreinte de chant, de poésie, de liturgie vivante et populaire. Ses mystiques, tel Isaac Louria à Safed, n’ont pas prêché une apocalypse imminente, mais la réparation progressive du monde (tikkoun olam). La Kabbale lourianique n’était pas un appel à la rupture brutale, mais une invitation à l’action patiente et humble : chaque acte juste, chaque bénédiction, chaque mitsva contribue à recoller les fragments brisés de la création. Le Zohar compare Israël à une « lampe qui éclaire sans se consumer », image d’une fidélité qui rayonne sans se transformer en incendie fanatique. Ici se révèle la différence : patience au lieu de violence, espérance au lieu d’impatience, réparation diffuse plutôt que grand soir révolutionnaire.
Aujourd’hui, alors qu’Israël est miné par ses divisions, nous devons entendre cette leçon. L’ashkénazisme a produit le meilleur comme le pire : une profondeur talmudique et philosophique d’un côté, des radicalités destructrices de l’autre. Le sépharadisme, lui, a produit une tradition moins spectaculaire mais plus harmonieuse : fidélité et ouverture, rigueur et souplesse, enracinement et dialogue. C’est ce que nous devons retrouver si nous voulons sauver Israël de ses propres fractures. Comme l’a rappelé Emmanuel Levinas : « le judaïsme, ce n’est pas une religion parmi d’autres, mais la responsabilité infinie pour autrui » (Difficile liberté). Cette responsabilité ne peut s’exercer ni dans l’enfermement ultra-orthodoxe qui nie le monde extérieur, ni dans l’utopie révolutionnaire qui nie la particularité d’Israël. Elle exige une voie médiane, une sagesse qui allie le particulier et l’universel, le singulier hébraïque et la vocation humaine.
Le Rav Yehouda Léon Ashkenazi, dit Manitou, a pensé cette distinction essentielle entre le judaïsme exilique et l’hébraïsme retrouvé : Le judaïsme d’exil s’est souvent réduit à une religion ; l’hébraïsme, lui, est une vocation historique, politique et spirituelle. Les sépharades, malgré les épreuves de l’exil, ont su préserver quelque chose de cette vocation, par leur lien vivant avec la culture environnante, par leur refus des murs infranchissables. Israël, pour survivre, doit redevenir hébreu au sens plein : non pas simple religion de rites et de doctrines, mais peuple souverain, enraciné dans sa terre, assumant sa responsabilité historique et ouvert à sa mission universelle.
La Bible elle-même en témoigne. Isaïe proclame : « Je t’ai donné pour lumière des nations, pour être mon salut jusqu’aux extrémités de la terre » (Isaïe 49,6). Ce verset n’appelle ni au fanatisme ni à la dissolution : il appelle à l’équilibre prophétique. La vocation d’Israël n’est pas de se fondre dans les peuples ni de s’enfermer dans sa singularité, mais de conjuguer enracinement et ouverture. Le Talmud, dans Sanhédrin 37a, enseigne : « Celui qui sauve une vie sauve un monde entier. » Voilà la clef : voir dans chaque être humain une parcelle de l’universel, sans jamais cesser d’être soi.
Ce manifeste est donc un appel. Israël doit se sauver de ses propres extrêmes. Nous n’avons pas vocation à reproduire indéfiniment les fractures héritées de l’Europe ashkénaze, entre ultra-orthodoxes séparatistes et gauchistes déracinés. Nous avons vocation à inventer une fidélité créatrice, enracinée dans la Torah mais ouverte au monde, enracinée dans la terre d’Israël mais consciente de sa mission prophétique. C’est cela, l’esprit sépharade : non pas une nostalgie du passé, mais une ressource prophétique pour l’avenir.
Il faut le dire clairement : l’avenir d’Israël ne peut pas être confisqué par des minorités bruyantes, qu’il s’agisse de ceux qui refusent de porter le fardeau de la souveraineté au nom d’une religion réduite à une identité sectaire, ou de ceux qui rêvent de dissoudre la nation au nom d’un humanitarisme sans racines. Le peuple juif ne peut vivre éternellement dans cette schizophrénie. Il doit retrouver l’équilibre méditerranéen de sa sagesse. Faute de quoi, comme l’écrivait Spinoza, lui-même fils de la tradition sépharade, « les passions extrêmes conduisent à la servitude de l’âme » (Éthique, IV, prop. 45).
Frères et sœurs d’Israël, ce texte n’est pas une analyse académique de plus : c’est un cri prophétique. Rejetez la tentation des extrêmes. Refusez l’enfermement qui nie la souveraineté, refusez la dissolution qui nie l’identité. Reprenez la route de vos pères, celle de l’équilibre, de la sagesse et de la fidélité vivante. C’est dans ce retour que se joue l’avenir du judaïsme, l’avenir d’Israël, et peut-être même l’avenir du monde. Car si Israël sombre dans ses fractures, le monde perd son témoin. Mais si Israël retrouve l’esprit sépharade, alors il redeviendra lumière parmi les nations.
Rony Akrich
Ashdodcafe.com
Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre groupe whatsapp et recevoir notre newsletter hebdomadaire en vous y inscrivant et en invitant vos amis à faire de même.