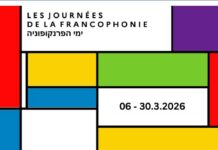Dans un monde traversé par les convulsions de l’histoire, guerres ouvertes ou larvées, économie militarisée, menaces nucléaires planant sur nos têtes comme une épée de Damoclès, il peut sembler presque incongru de parler d’amour. Et pourtant, c’est précisément dans ces heures sombres que ce mot, galvaudé par l’usage et déformé par le sentimentalisme, retrouve son sens le plus vital. Ainsi, parler d’amour aujourd’hui n’est pas fuir la réalité : c’est lui faire face avec l’arme la plus profonde dont dispose l’être humain. Loin d’être une naïveté, c’est un acte de lucidité et de résistance. Et c’est à ce geste que nous invite Fromm : réapprendre à aimer dans un monde qui, trop souvent, a oublié comment.
En 1956, Erich Fromm a publié « L’art d’aimer », un livre qui contredit la vision romantique traditionnelle de l’amour en Occident. Selon lui, l’amour n’est pas une force mystérieuse et irrésistible qui nous emporterait malgré nous. Il n’est pas non plus une simple pulsion ou une passion dévorante. Au contraire, il s’agit plutôt d’une pratique rigoureuse, d’une concentration constante et d’un engagement volontaire. Contrairement à l’opinion courante qui veut que l’amour soit spontané et inné, cette thèse affirme qu’il a le pouvoir de libérer de la compulsion de désir. Il déplace le centre de gravité du besoin à la volonté. Nous aimons croire que l’authenticité ne demande aucun effort : « si l’on doit essayer d’être soi-même, c’est qu’on ne l’est pas vraiment », répète-t-on souvent. Mais Fromm nous met en garde contre cette illusion. Pour lui, le véritable amour commence lorsque la phase enivrante des débuts s’estompe, quand la magie s’efface et que l’autre apparaît dans sa singularité irréductible, avec ses fragilités et ses instabilités. C’est alors seulement qu’il cesse d’être un rêve pour devenir un acte volontaire, parfois presque banal dans sa constance.
Fromm rejette l’idée que l’amour se vive passivement. Aimer, c’est un acte fort, une éthique de l’existence. Cela suppose concentration, patience, écoute, et surtout, une compétence qui s’apprend. Il propose de s’opposer à la culture moderne de la vitesse, de la performance et du jetable en promouvant une vision presque monastique : l’amour ne s’obtient pas par hasard, mais par un entraînement rigoureux, comparable à celui d’un artisan devant son établi. Aimer, ce n’est pas chercher à être validé, mais permettre à l’autre d’exister pleinement, en se tenant à ses côtés dans sa croissance, ou, si nécessaire, en se plaçant devant lui comme un rempart.
Cette réflexion prend racine dans le contexte de l’après-guerre: époque de reconstruction, de foi dans le progrès technique, mais aussi de solitude et de rigidité émotionnelle. La société de consommation transforme les sentiments en objets d’échange, les relations en contrats implicites de satisfaction mutuelle. L’idéal romantique se mêle à la logique du marché: on choisit un partenaire comme on sélectionne un produit rare, conforme à nos attentes, prêt à « me compléter ». Mais Fromm rappelle qu’aimer, c’est accepter l’imprévisible, se confronter à une altérité qui échappe à notre contrôle.
Aimer ainsi devient un acte de résistance à la déshumanisation. C’est dire non à la volonté de tout contrôler, à l’obsession de prédire et de planifier. L’amour véritable suppose d’accueillir l’incertitude, le silence, la distance, les désaccords. Ce n’est pas contourner la réalité, mais l’affronter ensemble. Sur ce point, Fromm rejoint Kierkegaard, pour qui aimer est un saut dans l’inconnu, un abandon volontaire à quelque chose qui nous dépasse. Il rejoint aussi Martin Buber, qui décrit la relation authentique comme un face-à-face, le Je-Tu. où le divin s’invite dans l’espace entre deux êtres. Et il rencontre Emmanuel Levinas, qui fait de l’amour une éthique du visage : l’autre m’appelle avant même que je le comprenne, et cette responsabilité envers lui précède tout savoir.
Dans un monde obsédé par la sécurité et la fonctionnalité, les émotions sont codifiées, institutionnalisées. Une fois réglementées, elles perdent leur force vitale, cessant d’être un fait brut de l’existence. Fromm rappelle que la capacité à aimer, malgré les conflits, est la clé de toute coexistence humaine. C’est elle qui rend une société à la fois douce et solide. Ainsi, à l’ère de l’efficacité et de l’isolement, l’amour, compris comme pratique patiente et gratuite, acquiert une dimension politique. Il ne se réduit pas à la sphère intime : il propose un modèle social où l’accueil de l’autre, le soin et la gratuité constituent la norme.
Simone Weil, dans cette lignée, affirme que l’attention pure, désintéressée, qui ne prend rien mais se laisse toucher, est déjà une forme d’amour. Dans cette logique, aimer n’est pas posséder, mais offrir un espace où l’autre peut exister, même dans son mystère. Cet amour est une force quasi divine, une foi laïque dans le fait que l’autre, aussi différent soit-il, représente un présent qui élargit mon horizon et me transforme. L’aimé n’est pas là pour combler un vide, mais pour élargir ma capacité à vivre.
Fromm voit dans cette éducation à l’amour un enjeu social majeur. La famille, l’école, l’espace public devraient devenir des lieux d’apprentissage de l’écoute, de la patience et de la résolution des conflits. Aimer devient alors un acte de résistance contre la marchandisation des relations et un moteur de solidarité, d’amitié et de dialogue. Les relations amoureuses ne sont plus seulement une affaire privée : elles sont un laboratoire de persévérance, de coopération et de croissance mutuelle.
Dans un monde où tout s’accélère, aimer exige la lenteur. Dans un monde saturé de bruit, il réclame le silence. Dans un univers régi par l’utilité, il défend la gratuité. L’amour profond devient alors un acte de rébellion contre le nihilisme ambiant. Rilke écrivait que « pour qu’un être humain en aime un autre, c’est peut-être la plus difficile de toutes nos tâches… c’est regarder dans la même direction ». L’amour ne supprime pas la solitude, mais il rend possible une solitude habitée.
Si nous échouons à aimer, avertit Fromm, nous réduisons l’humanité à ses seuls instincts bruts. Alors ne restent que la peur et la survie. Aimer, c’est retrouver notre dignité, comme le disait Abraham Heschel : « L’homme est un être de sens et de rayonnement. » L’amour nous rappelle que nous sommes plus que des organismes en quête de sécurité : nous sommes capables de nous élever au-dessus de notre condition.
Cet amour est exigeant. Il demande du courage, car il expose à la blessure. Il implique de renoncer à certaines illusions de maîtrise. Il suppose aussi d’accepter que l’autre ne soit pas toujours à la hauteur de nos espérances, et que nous-mêmes ne le soyons pas toujours pour lui. Mais c’est précisément dans cette zone de vulnérabilité réciproque que l’amour trouve sa vérité. Car aimer, ce n’est pas vouloir façonner l’autre à notre image, mais le laisser advenir à lui-même, même si cela nous déroute.
C’est pourquoi l’amour, dans la perspective de Fromm, n’est pas une fuite dans l’intimité fermée, mais un engagement ouvert sur le monde. Aimer, c’est montrer qu’une autre manière de vivre ensemble est possible: une société où la valeur d’une personne ne se mesure pas à sa rentabilité, mais à la qualité de son attention et à la générosité de sa présence. Ainsi compris, l’amour devient la matrice de toute politique humaine digne de ce nom.
Dans notre époque d’accélération et de distraction permanente, un tel amour est une discipline de décélération. Dans un univers saturé de messages instantanés, il est une école du silence. Dans une économie centrée sur l’échange et le profit, il est une pratique de la gratuité. Dans un climat social dominé par la peur et la méfiance, il est un acte de foi, non pas en une idée abstraite, mais en la réalité de l’autre.
Aimer n’est donc pas seulement une affaire privée, c’est une responsabilité historique. C’est le dernier refuge de l’humanité face à la fragmentation et à la marchandisation de l’existence. C’est ce qui peut encore nous sauver du nihilisme qui s’installe lorsque plus rien n’a de valeur en soi. Comme le disait Fromm, l’amour véritable n’est pas la satisfaction d’un désir, mais la volonté ferme de cultiver un lien, de le protéger et de le nourrir, même, et surtout, lorsque ce lien traverse des zones d’ombre.
L’amour est difficile, exigeant, parfois douloureux. Mais sans lui, c’est déjà mourir un peu. Peut-être est-ce là le seul héritage digne d’être transmis : non pas une promesse de bonheur garanti, mais ce dernier sanctuaire humain où persiste ce qui nous rend vraiment humains.
Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre groupe whatsapp et recevoir notre newsletter hebdomadaire en vous y inscrivant et en invitant vos amis à faire de même.