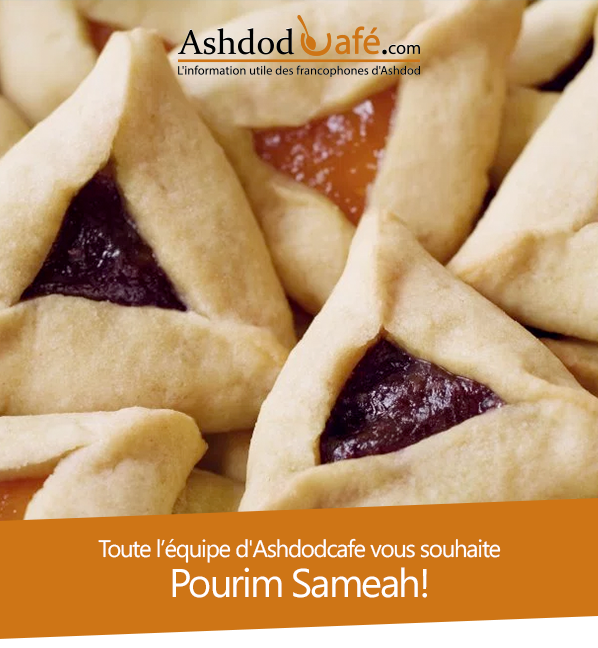Je soignais en soins palliatifs, au sein du département d’oncologie, des malades en fin de vie. Ce n’était pas une fonction ni une spécialité médicale parmi d’autres : c’était une traversée partagée. Au début, je croyais apporter quelque chose à ceux qui allaient mourir ; avec le temps, je comprenais que je laissais surtout quelque chose de moi au chevet de chacun : ma voix, mon regard, mes tremblements. Là où la médecine classique combattait la mort, nous apprenions à la regarder en face, puis à lui parler, puis à nous taire avec elle. On ne guérissait plus, on accompagnait ; on ne prolongeait plus, on élevait. Ce que nous soignions, ce n’était plus le corps seul, c’était l’âme fatiguée par le temps, ce visage qui cherchait encore une dernière confirmation : « ai-je compté pour quelqu’un ? ».
L’empathie soignante commençait par une chose simple et vertigineuse: accepter de se laisser toucher. Je laissais la main du malade serrer la mienne un peu trop longtemps. J’entendais la plainte revenir, sans me cacher derrière l’humour ou le jargon. Je consentais à ressentir, en moi, quelque chose de son angoisse, sans m’y dissoudre. Je ne venais pas seulement avec des protocoles ; je venais avec ma propre histoire, mes peurs, mes fragilités. Le soin palliatif n’exigeait pas que je sois invulnérable, il exigeait que je sois présent. Cette présence avait un prix: elle me fatiguait, m’entamait, fissurait mes défenses, mais c’était le seul chemin pour que l’autre ne soit pas réduit à un lit ou à un numéro de chambre.
La fin de vie n’était pas, pour moi, un échec de la science, mais le retour du mystère. Tout être humain, au moment de mourir, retrouvait une nudité originelle qui précédait et succédait à la conscience. Je voyais des hommes puissants redevenir enfants, cherchant dans mon regard la permission de pleurer. Je voyais des athées prier en silence, et des croyants douter avec douceur de ce Dieu qui ne répondait pas comme ils l’avaient espéré. Je voyais des familles se déchirer pour un détail, puis se réconcilier sur un souffle, sur un « pardon » à peine audible. Dans ces chambres, la mort ne détruisait pas seulement les illusions ; elle rendait à chacun son vrai visage, celui qu’aucune fonction ni aucune richesse ne pouvait sauver.
Ce n’était pas tant la mort que nous redoutions, c’était la perspective de devenir insignifiants. Être là sans que personne ne nous voie, ne nous nomme, ne prenne le temps de parler autrement que par des ordres techniques. Mourir seul dans un couloir d’hôpital, entouré de machines, sans parole ni regard, me paraissait comme le scandale véritable. L’empathie soignante naissait de ce refus : je ne pouvais pas empêcher la mort, mais je pouvais empêcher l’abandon. Le soin palliatif devenait une résistance silencieuse à la déshumanisation, un refus de la froideur technologique et du déni de la finitude. Là où certains auraient voulu supprimer la souffrance en supprimant le souffrant, nous choisissions la fidélité : rester auprès, écouter, soulager, aimer sans illusion, mais sans abandonner.
Soigner en fin de vie, c’était accepter de ne plus être le maître du destin, mais le témoin de l’essentiel. Les gestes médicaux restaient nécessaires, ajuster un traitement, apaiser une douleur, humidifier des lèvres, mais ils n’étaient plus le centre. Le centre, c’était ce lien fragile entre un corps qui lâchait et un regard qui tenait bon. L’empathie, ce n’était pas pleurer à la place de l’autre, c’était accueillir ses larmes sans détourner les yeux. Dans chaque respiration arrachée, dans chaque sourire épuisé, je percevais une évidence : l’être humain n’était pas un dossier, ni un cas, ni un lit occupé. Il demeurait une parole incarnée, même lorsque les mots ne sortaient plus.
Cette empathie avait ses dangers. Si je me confondais avec la douleur du patient, je m’effondrais avec lui ; si je m’en protégeais trop, je devenais indifférent. Entre ces deux abîmes, il fallait trouver une juste distance, ni froideur, ni fusion. Certains soirs, je rentrais chez moi avec des visages qui m’accompagnaient, des phrases qui résonnaient dans ma nuit. Je repensais à cette femme qui m’avait dit : « Je n’avais plus peur de mourir, j’avais peur que personne ne se souvienne de moi. » Ou à cet homme qui m’avait demandé de dire à son fils qu’il avait fait de son mieux. Ces confidences ne s’effaçaient pas : elles s’inscrivaient en moi comme des cicatrices discrètes et m’obligeaient à relire ma propre vie.
La mort, quand elle venait, ne détruisait pas tout : elle révélait. Elle mettait à nu ce qui, en nous, résistait à la vérité. Si nous en avions si peur, c’était peut-être parce qu’elle ramenait chacun à une question que la vie permettait d’éviter : qu’avais-je vraiment aimé, et qu’avais-je fait de cet amour ? Au chevet des mourants, cette question n’était plus théorique, elle devenait prière, soupir, murmure. Je voyais défiler dans leurs yeux des visages, des regrets, des joies, des occasions manquées. Mon rôle n’était pas de répondre à leur place, mais de rester là pendant qu’ils affrontaient ce bilan intérieur.
Accompagner, c’était entrer dans une éthique du regard. Ne pas détourner les yeux quand le corps se déformait, quand l’odeur devenait difficile, quand la peau se marquait. Refuser de réduire l’autre à sa douleur, à son agitation, à son silence. Ne pas confondre la pitié avec la compassion : la pitié regardait de loin et gardait ses distances ; la compassion s’inclinait, acceptait d’être touchée, mais restait debout pour soutenir. Parfois, l’acte le plus empathique consistait simplement à dire : « Je suis resté là. Je ne t’ai pas quitté. » Et à tenir cette parole jusqu’au bout.
Je rêvais d’une société qui n’aurait plus peur de la finitude, qui saurait accueillir ses morts, leur parler encore, leur garder une place. Une société où l’on apprendrait aussi les gestes de « derniers secours » : tenir une main, écouter un silence, accompagner un souffle qui s’éteint. Une société qui ne confierait pas aux seules machines la décision du dernier instant, mais assumerait la responsabilité d’une présence humaine. Car soigner en fin de vie, c’était rappeler que la liberté ne disparaissait pas avec la force du corps : tant qu’il restait un choix, même minuscule, il restait une dignité à honorer.
Au chevet de ceux qui s’en allaient, je découvrais que la mort n’était pas seulement la fin de la vie, mais l’ultime forme de la relation. On pouvait encore aimer un mourant, et il pouvait encore aimer. Cet amour-là ne promettait plus d’avenir ; il condensait, dans l’instant, la fidélité de toute une vie. L’empathie soignante se nourrissait de cet amour : elle ne se mesurait pas au nombre de gestes techniques, mais à la qualité de présence.
Je signe ce texte comme un témoin. Témoin de ces instants où la grandeur humaine se révélait dans le dépouillement, où un regard, une main, un souffle disaient plus que tous les discours. Le soin palliatif était, pour moi, un acte de résistance spirituelle, un acte de foi dans la dignité de l’homme jusqu’à son dernier souffle. Si je devais résumer en un mot cette expérience, je dirais : présence. Une présence empathique, vulnérable, obstinée, qui sauvait ce qui pouvait l’être, non pas de la mort, mais de l’oubli.
© 2025 Rony Akrich — Tous droits réservés / All rights reserved
Ashdodcafe.com
Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre groupe whatsapp et recevoir notre newsletter hebdomadaire en vous y inscrivant et en invitant vos amis à faire de même.