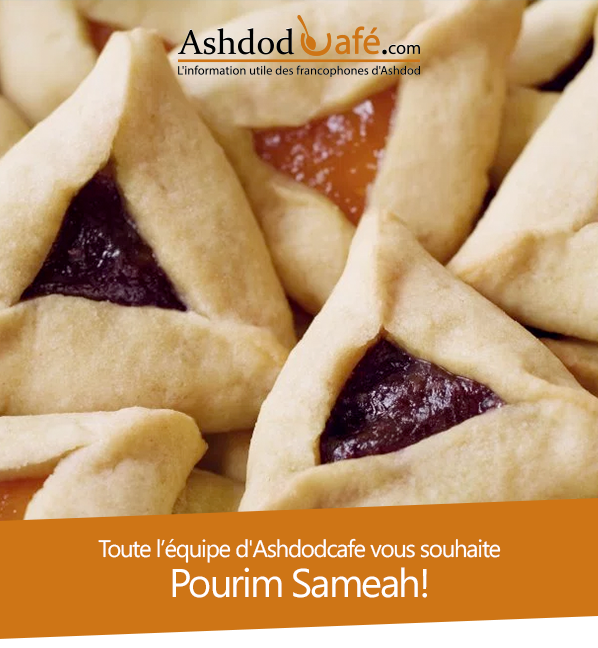L’histoire juive connaît des instants de bascule, des secousses qui réveillent, chez certains esprits convaincus d’avoir dépassé leur condition, une conscience qu’ils croyaient révolue. À cinquante-six ans d’écart, deux événements aussi dissemblables que la guerre des Six Jours en 1967 et le massacre du 7 octobre 2023 ont provoqué, chez des Juifs assimilés, un choc existentiel profond. L’un comme l’autre ont agi comme un miroir brutal : à ceux qui pensaient pouvoir vivre en marge de l’histoire juive, ils ont renvoyé l’image de leur propre vulnérabilité.
Ce fut le cas de Raymond Aron en 1967. C’est aujourd’hui celui de Sam Harris. Tous deux, rationalistes, sceptiques, portés vers l’universel plus que vers la mémoire, ont été contraints de reconnaître que, pour les Juifs, la part sombre de l’Histoire ne se laisse jamais désarmer.
En juin 1967, face à la menace explicite d’un second anéantissement du peuple juif, Raymond Aron, figure singulière de la vie intellectuelle française, est saisi par l’angoisse. Philosophe libéral, sociologue de formation, éditorialiste au Figaro, il avait toujours refusé de faire de sa judéité une identité essentielle. Mais la rhétorique exterminationniste de Nasser et la mobilisation des armées arabes ébranlent sa confiance dans le progrès humain. Dans une tribune restée célèbre, Aron confesse : « Je me découvre solidaire d’un peuple. »
Lui qui s’était voulu spectateur des passions collectives devient solidaire malgré lui. Ce n’est ni une conversion identitaire, ni un ralliement émotionnel : c’est un réveil, une cassure intérieure. Il comprend que l’assimilation ne protège pas de tout. Qu’aucune intégration ne met à l’abri d’un destin collectif dont on croyait s’être affranchi. L’Histoire le rappelle à l’ordre. Il découvre que la menace existentielle fait toujours partie de la condition juive. Et il va plus loin encore, dans une phrase qui dit tout de cette secousse intime : « Peu importe d’où [la solidarité] vient. Si les grandes puissances laissent détruire le petit État d’Israël qui n’est pas le mien, ce crime modeste à l’échelle du monde m’enlèverait la force de vivre. »
Presque six décennies plus tard, Sam Harris, philosophe américain athée, célèbre pour sa critique des religions, vit un sursaut comparable. Longtemps, il avait rejeté le sionisme comme un vestige de pensée tribale, incompatible avec l’idéal universaliste. Mais après l’attaque du 7 octobre 2023, il exprime un retournement spectaculaire. Dans un épisode de son podcast, Harris déclare : « Je détestais le sionisme jusqu’au 7 octobre. Puis tout a changé » ( I hated Zionism until October 7th. Then everything changed) . Ce qui le bouleverse n’est pas seulement la violence du Hamas, mais le refus, chez de nombreux intellectuels occidentaux – notamment à gauche – de la reconnaître comme un mal objectif. L’indifférence, le déni, les justifications perverses le poussent à reconsidérer ses convictions les plus ancrées.
Harris, sans renier sa posture critique, se dit désormais « sioniste convaincu ». Non par idéologie, mais par lucidité. Comme Aron, il découvre que la sécurité juive n’est jamais définitivement acquise. Que le monde post-Holocauste, qu’il espérait rationnel et apaisé, peut soudain se briser. Ces retournements ne sont pas anecdotiques : ils révèlent la persistance, chez des penseurs assimilés, d’un lien au destin juif que ni l’intelligence ni la distance critique ne parviennent à dissoudre. Ils témoignent d’un sionisme de nécessité, qui ne repose ni sur le messianisme ni sur le nationalisme, mais sur un constat : l’Histoire n’en a pas fini avec les Juifs, et l’État d’Israël, malgré ses contradictions, demeure une réponse politique aux menaces récurrentes.
D’autres grandes figures ont, à différents moments, connu des prises de conscience similaires. George Steiner, intellectuel viennois, critique littéraire et philosophe du langage, voyait dans le judaïsme une fidélité à l’exil, à la dispersion, au non-pouvoir. Le génie juif, pensait-il, naissait de cette tension entre marginalité et universalité. Pour lui, le judaïsme devait rester parole, errance, incertitude.
Mais dans les dernières années de sa vie, Steiner laisse entrevoir un trouble. Dans un entretien avec Laure Adler en 2014, publié sous le titre Un long samedi, il confie : « Dire que Netanyahou est dans l’erreur, c’est facile quand on est dans un beau salon à Cambridge. C’est là-bas qu’il faut le dire. Et tant qu’on n’y est pas, à vivre de tout son être en otage de la situation, je crois qu’il vaut mieux se taire. […] Il y a des moments où je voudrais partir et y être. Des moments où je me demande si je n’aurais pas dû aller en Israël. » Cette confession pudique et déchirée ne marque pas une conversion, mais l’effritement d’un dogme diasporique. Le vieux penseur du déracinement reconnaît, au seuil de la mort, le désir d’un lieu.
Primo Levi, chimiste de formation, écrivain humaniste, rescapé d’Auschwitz, fut un témoin lucide de la Shoah. Il croyait en la mémoire comme rempart contre la barbarie. Mais dans ses dernières années, une inquiétude croissante traverse ses écrits. Il répète cette phrase, devenue avertissement : « Cela s’est passé, donc cela peut se reproduire. » Levi sent que la mémoire faiblit, que la conscience s’émousse, que le retour du mal est possible. Ce n’est pas un appel au repli, ni une conversion au sionisme. Mais, comme chez Aron, Harris ou Steiner, on perçoit une intuition du péril : l’idée que l’humanité éclairée peut rechuter dans l’inhumanité. Et que les Juifs, encore une fois, seront une cible.
Ces réveils ne mènent pas tous à la même conclusion. Ils n’aboutissent pas à un alignement idéologique. Mais ils partagent une forme de lucidité : la conscience que, pour les Juifs, l’Histoire n’est pas un refuge. Que l’universalisme ne protège pas de l’assignation. Que même l’assimilation la plus aboutie peut être transpercée par la flèche du destin. Et que, dans ces moments-là, le sionisme, loin d’être un projet dogmatique, peut apparaître comme une boussole minimale. Non pour rêver de grandeur, mais simplement pour continuer à vivre.
Ni Aron, ni Harris, ni Steiner, ni Levi n’ont renoncé à leur pensée critique. Mais tous, à leur manière, ont été contraints de faire retour sur eux-mêmes. Le sionisme qu’ils entrevoient, acceptent ou réévaluent, n’est pas triomphant. C’est un sionisme tragique et modeste, ancré dans la mémoire du péril. Un sionisme sans illusions. Un sionisme de rappel.
Daniel Horowitz
Ashdodcafe.com
Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre groupe whatsapp et recevoir notre newsletter hebdomadaire en vous y inscrivant et en invitant vos amis à faire de même.