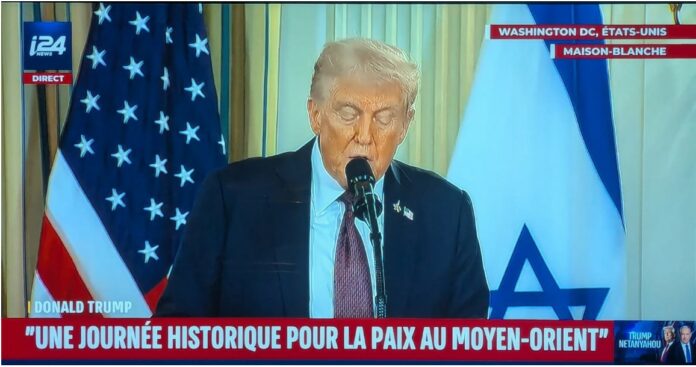Depuis sa création, l’État d’Israël entretient avec les États-Unis une relation d’une intensité exceptionnelle, sans équivalent dans son environnement international. Ce lien, pourtant, ne se réduit pas à une communauté d’intérêts : il s’enracine dans une histoire partagée, mais s’exprime aussi à travers des tensions, des attentes et une asymétrie dans le rapport de forces. On peut y voir à la fois l’un des piliers de la stabilité du Proche-Orient et l’une des contraintes les plus fortes pesant sur la souveraineté israélienne. Dès lors, la question se pose de savoir si ce soutien relève d’une forme de vassalisation ou s’il constitue une alliance librement consentie.
Le soutien américain à Israël est multiple et institutionnalisé. Il s’exerce d’abord sur le plan militaire, à travers des programmes d’assistance destinés à garantir à Israël un avantage technologique décisif. Depuis les années 1980, la législation américaine consacre le principe du maintien de l’« avantage militaire qualitatif » d’Israël sur tout adversaire régional¹. Ce principe s’est traduit par une série d’accords de coopération, dont le dernier en date engage Washington à une aide massive sur dix ans², incluant notamment le financement de systèmes antimissiles tels que le Dôme de fer ou la Fronde de David³. À ce volet militaire s’ajoute un appui diplomatique, illustré par l’usage du veto américain au Conseil de sécurité pour bloquer des résolutions jugées hostiles à Israël⁴. La coopération bilatérale s’étend encore aux domaines du renseignement, du commerce et de la technologie, encadrés par des accords de libre-échange⁵ et par une circulation d’expertise entre les deux pays.
Les racines de ce soutien plongent dans un imaginaire historique, culturel et moral. Dans la conscience américaine, Israël apparaît comme une démocratie née d’un idéal de liberté et de résilience. L’identification entre les deux nations, nourrie d’affinités religieuses et politiques, a résisté aux alternances de pouvoir. Le Congrès a d’ailleurs toujours constitué un point d’ancrage solide de la relation bilatérale⁶. Pour les États-Unis, Israël incarne, au cœur d’une région instable, un partenaire sûr, technologiquement avancé et aligné sur les valeurs occidentales. L’alliance procède ainsi d’une convergence d’intérêts et d’une proximité de valeurs que la permanence du chaos moyen-oriental n’a fait que renforcer.
Cette relation n’en demeure pas moins l’objet de débats croissants aux États-Unis, sur l’ensemble du spectre politique. À gauche du Parti démocrate, la mouvance dite « progressiste » — issue en partie des milieux universitaires et militants — a connu, au cours des dernières années, une radicalisation marquée. Depuis la guerre de Gaza, cette gauche se structure autour d’une hostilité quasi exclusive à Israël, devenue le centre symbolique de sa critique du pouvoir et de la domination occidentale. Sous couvert d’anticolonialisme et de solidarité avec les Palestiniens, elle a fait de la délégitimation d’Israël une cause idéologique globale, s’inscrivant dans un courant d’extrême gauche transnational dont les mots d’ordre circulent entre les campus américains, les ONG et les mouvements militants européens.
L’antisionisme est devenu un langage de substitution pour un antisémitisme réactivé, souvent conscient, parfois dissimulé. Israël y est présenté comme l’incarnation du mal politique — État colonial, oppresseur, raciste — et, à travers lui, c’est le judaïsme dans sa dimension historique et collective qui se trouve stigmatisé. Les mobilisations sur les campus, leurs slogans, leurs violences⁸, traduisent ce glissement idéologique. Ce militantisme, qui se revendique de la justice et de l’antiracisme, nourrit en réalité une haine spécifique, où antisionisme et antisémitisme se confondent. Les données récentes attestent d’une explosion de ces manifestations⁹, dont la fréquence et la virulence révèlent moins une critique politique d’Israël qu’une animosité dirigée contre les Juifs eux-mêmes.
À droite, une autre forme de réticence s’exprime, d’ordre plus identitaire et pragmatique. Les courants isolationnistes considèrent que les ressources américaines devraient être consacrées avant tout à la politique intérieure, à la protection des frontières et à la rivalité croissante avec la Chine¹⁰. Une certaine lassitude stratégique s’installe : celle d’une puissance qui craint de se disperser dans des causes qui ne sont pas les siennes. L’ombre du Vietnam continue de hanter la conscience politique américaine¹¹. Ainsi, le soutien à Israël se trouve pris entre deux critiques opposées mais convergentes : l’une, morale et idéologique, issue de la gauche radicale ; l’autre, nationaliste et désengagée. Sans remettre en cause le partenariat lui-même, cette double pression en fragilise le consensus politique.
Une alliance fondée sur un soutien aussi massif ne peut être exempte d’attentes. Les États-Unis disposent de leviers: livraisons d’armes, garanties de prêts, positions à l’ONU. L’histoire en offre plusieurs exemples, tels la suspension de garanties en 1991 pour inciter Israël à geler les implantations¹², ou, plus récemment, le ralentissement des livraisons d’armes dans le contexte de la guerre de Gaza¹³. Ces épisodes rappellent que le soutien américain, loin d’être inconditionnel, s’accompagne de contraintes.
Reste à savoir quelles obligations, explicites ou implicites, ce soutien impose à Israël. L’État hébreu conserve la maîtrise de sa politique étrangère et de sa stratégie militaire, mais sa dépendance à l’aide américaine introduit une forme d’astreinte politique. Israël reconnaît que sa sécurité dépend en partie d’un consensus à Washington, et qu’il lui faut donc ménager cet équilibre. Préserver la reconnaissance due à un allié sans renoncer à l’autonomie nécessaire à sa survie : tel est le dilemme. Jusqu’où la gratitude peut-elle aller sans devenir dépendance ? Et jusqu’où la souveraineté peut-elle se défendre sans paraître ingrate ?
L’expérience montre qu’Israël sait affirmer ses lignes rouges, y compris face à la pression américaine. En 1956, après l’intervention du Sinaï, la contrainte exercée par Washington avait conduit au retrait israélien, mais non sans garanties de sécurité¹⁴. En 1981, lors du bombardement du réacteur irakien d’Osirak, Jérusalem avait agi sans consultation préalable, assumant la réprobation de son allié au nom d’un impératif vital¹⁵. Plus récemment, dans sa confrontation avec l’Iran, Israël a maintenu une politique de liberté d’action, considérant les ambitions nucléaires de Téhéran comme une menace existentielle justifiant une latitude stratégique totale¹⁶.
Avant que les États-Unis ne deviennent le principal soutien d’Israël, c’est la France qui joua, des années 1950 jusqu’à la guerre des Six Jours, le rôle d’allié privilégié. Entre les deux pays régnait alors une réelle complicité politique et militaire. L’armée israélienne s’équipait en grande partie de matériel français — notamment les avions Mirage, décisifs lors de la Guerre des Six-Jours en 1967 — et c’est avec l’appui technique de la France que furent posées les bases de la capacité nucléaire israélienne, officieuse mais largement reconnue¹⁷. Ce précédent rappelle combien les alliances traduisent des conjonctures et des équilibres de puissance susceptibles d’évoluer.
C’est peut-être à cette lumière qu’il faut comprendre la solidité de la relation américano-israélienne. Les États-Unis savent que leur soutien n’a de sens que s’il s’adresse à un partenaire responsable. Israël, pour sa part, mesure la sécurité que lui confère cette alliance, mais sait aussi qu’il ne doit pas s’y abandonner. L’équilibre repose sur une reconnaissance des limites de chacun : l’Amérique ne saurait dicter la conduite d’un État né d’une lutte pour la survie, tandis qu’Israël ne peut ignorer que son autonomie repose, pour partie, sur la bienveillance d’un allié puissant. Cette tension est le signe d’une maturité politique.
Israël n’est pas le vassal des États-Unis. Leur relation relève d’une interdépendance fondée sur des intérêts et une certaine vision du monde. Les contraintes qui en découlent s’exercent dans le cadre d’un dialogue où la confiance est déterminante. La souveraineté, pour Israël, ne consiste peut-être pas à se passer de l’Amérique, mais à savoir lui tenir tête lorsque la nécessité l’exige, sans rompre le fil de cette alliance, où dépendance et liberté coexistent dans un équilibre fragile mais vivant.
***
- S. Arms Export Control Act, Section 36(h) (amendements de 2008 et 2012) : reconnaissance légale du « Qualitative Military Edge ».
- Memorandum of Understanding 2016 : Fact Sheet, U.S. Department of State, 14 septembre 2016.
- Congressional Research Service (CRS), « S. Foreign Aid to Israel », 2023.
- Données ONU : 45 vetos américains en faveur d’Israël entre 1972 et 2023 (ONU, Département des affaires politiques).
- S.–Israel Free Trade Agreement, 1985.
- Résolutions annuelles du Congrès sur l’aide militaire, cf. CRS: U.S. Foreign Assistance to Israel.
- Sondage Gallup, 2024 : appui démocrate à Israël passé sous 50 %.
- The New York Times, avril–mai 2024 : couverture des campements pro-palestiniens sur les campus (Columbia, UCLA, etc.).
- Anti-Defamation League (ADL), « Audit of Antisemitic Incidents 2023–2024 » : hausse de +360 % aux États-Unis depuis octobre 2023.
- Discours de J. Vance et D. Trump (2023–2024) ; analyses Brookings Institution sur l’isolationnisme républicain.
- Council on Foreign Relations, « The Vietnam Syndrome Revisited », 2021.
- New York Times, 6 septembre 1991 : « Bush Seeks to Delay Loan Guarantees to Israel ».
- Reuters, mai 2024 : « S. pauses shipment of 2,000-lb bombs to Israel over Rafah concerns ».
- Avi Shlaim, The Iron Wall, Oxford University Press, 2000, chap. 3.
- Martin Van Creveld, The Sword and the Olive, PublicAffairs, 1998.
- International Crisis Group, « Israel’s Shadow War with Iran », 2022.
- Pierre Razoux, Tsahal : Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, 2017 ; Avner Cohen, Israel and the Bomb, Columbia University Press, 1998.
Ashdodcafe.com
Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre groupe whatsapp et recevoir notre newsletter hebdomadaire en vous y inscrivant et en invitant vos amis à faire de même.