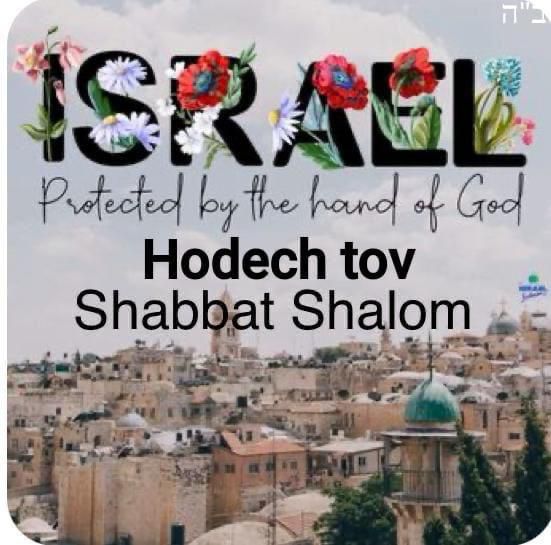ASHDOD – TEL AVIV 19h21 – 20h22
JÉRUSALEM – 19h00 – 20h21
La parole engage – Soyons fidèles à nos promesses.
Unité du peuple – Solidarité avant tout, même dans la diversité.
Les étapes de la vie – Chaque étape compte, même les plus difficiles.
Vers la Terre promise – Se préparer avec foi, responsabilité et vision.
➡️ Une paracha qui nous rappelle que chaque parole, chaque choix et chaque pas ont du sens.
Shabbat Shalom à toutes et à tous
Ce shabbat nous entrerons dans Hodesh Av et, en conséquence, selon les règles ci-jointes de « hashavoua shéhal bo » (la semaine dans laquelle le jeûne a lieu), nous n’avons, pour ceux qui suivent cette règle du Rav Ovadia Yossef zatsal, pas de semaine maigre sauf pour nos frères et soeurs de rite ashkenaze ou tout simplement ceux qui veulent être plus rigoureux.
LA GUERRE CONTRE MIDIANE
Les trois parashiot qui sont généralement lues entre le 17 tamouz et le 9 av sont appelées « DéPour’ânouta » c’est-à-dire « les lectures du désastre » car elles précèdent la destruction du Temple ce qui fut un désastre pour la Nation Juive et, après le 9 av, il y aura 7 sidroth dites de consolation. La péricope précédant 9 beav est « devarim », première section du 5ème livre du Pentateuque. Cette semaine seront donc couplées les deux dernières lectures du livre des Nombres.
Dans la première, « Matoth », il sera question plus particulièrement des vœux, tandis que dans la seconde, il sera question de la guerre livrée aux Midianites et de tous les petits détails qui font de cette guerre une guerre sainte.
Une étude a déjà été consacrée les années précédentes aux vœux mais nous nous y arrêterons tout de même car, les vœux font partie de la vie quotidienne et, si un traité entier de Talmud en parle (massékheth Nedarim), et, si à l’entrée du jour le plus sanctifié de l’année (Yom Kippour), une prière spéciale est consacrée aux vœux : KOL NIDRE, c’est que le sujet mérite qu’on y réfléchisse un peu.
Voici donc, en survol, de quoi il s’agit précisément : Pour des milliers de raisons comme le désarroi, le besoin d’exprimer au Créateur notre désir ardent de voir se réaliser quelque chose même s’il s’agit parfois, à nos yeux, d’un miracle – guérison d’un être cher par exemple- une personne peut être amenée à promettre quelque chose à l’Eternel, nous prendrons ici l’exemple de Jacob qui, se dirigeant vers son oncle Laban et faisant ce songe de l’échelle amasse des pierres à cet endroit précis sur lequel il promet de construire un sanctuaire.
HaShem ne prise pas tellement les vœux mais, si déjà un vœu a été prononcé, il faut le tenir. Si, un vœu a été promis par une femme, ou un enfant et que l’époux ou le père l’apprend, il peut annuler cette parole immédiatement et s’il n’y a pas ni père ni époux, un rabbin peut évidemment annuler la promesse mais, dans le cas d’un homme il faudra un quorum de 3 hommes ou selon le cas, un minyane.
Certains exégètes se sont posé la question de savoir pourquoi l’épisode de cette guerre est accolé à celui des vœux ou bien, en d’autres termes, pourquoi le sujet de la guerre pour HaShem est-il accolé aux « vœux » ? Le fait est, qu’en cas de détresse, l’homme a recours à un vœu pour demander au Créateur une mesure de miséricorde supplémentaire et, promet quelque chose, en contrepartie.
Un verset interpelle notre attention : il est écrit : ‘ה ציוה אשר הדבר זה . Ainsi que nous avons déjà souvent eu l’occasion de le remarquer ce mot de trois lettres hébraïques : davar qui signifie une chose mais aussi une parole possède une signification très importante. Or, il est intéressant de noter que Moïse en s’adressant aux chefs de tribus leur signale : voici la parole que D a ordonnée !
Par ce mot, le Prophète enseigne que si un homme prononce une parole de manière à s’imposer un vœu ou faire une promesse il devra mettre en pratique ce qu’il aura prononcé s’il s’agit d’une obligation ou d’une privation à propos desquelles l’homme a fait une promesse, il doit observer et accomplir ce qui a été promis comme par exemple faire un don à une personne ou à une association dès que le vœu ou le serment ont été prononcés, cela devra être accompli. Ceci vient nous enseigner qu’il n’est pas conseillé de prononcer des paroles à la légère. L’homme se distingue de la créature animale par le don de la parole. Rappelons à ce propos que lorsque l’être humain doit communiquer c’est par la parole, s’il doit prier c’est encore par la parole qu’il s’adresse au Créateur. Et dans ce domaine nous devrons nous diriger vers le bien et veiller à ne prononcer que de bonnes paroles.
C’est en prononçant des paroles que D créa le monde et c’est en en prononçant d’autres que le déluge s’abattit sur le monde pour le détruire. De même les uns les autres se sont encouragés par la parole à construire la tour de Babel et c’est à cause de ces paroles qu’ils ne se sont plus compris.
C’est par 10 paroles magistrales que D nous a comblés en nous offrant Sa Loi. La parole possède donc une force intellectuelle et morale de même qu’elle a une valeur et que, si elle peut être employée à tort et à travers elle comporte la faculté de véhiculer une sainteté incommensurable et la parole peut donc être le véhicule de la consécration et de la dédication c’est la raison pour laquelle le texte nous précise que dès que le vœu ou que le serment est prononcé il ne pourra être profané. Pourtant, l’être humain n’étant pas toujours capable de sublimer ses sentiments et ses émotions il aura pu s’engager dans un vœu pour lequel, au fond, il ne souhaitait pas s’engager et c’est la raison pour laquelle, D a prévu une possibilité de revenir sur sa parole.
La Torah demande aux membres du peuple juif d’observer la Torah sans en ajouter ou sans en retirer quoique ce soit. Se pose alors, la problématique suivante : pourquoi une personne pourrait-elle s’interdire un aliment ou un acte ou s’imposer ou autoriser un acte ? La réponse est que de par son libre arbitre la personne peut s’imposer pour une raison quelconque un acte quelconque et il faudra veiller soit à le mettre en pratique soit à s’en faire relever.
Nous rappellerons, que l’une des raisons de la destruction du Temple est la haine gratuite tout comme cette haine qui s’était perfidement installée entre Joseph et ses frères. Or, ce sont précisément les Midyanites qui ont vendu Joseph aux Egyptiens.
Le chemin de ce peuple croisa le nôtre à plusieurs reprises : le prêtre de Midyane, Yithro, lui-même, se trouvait parmi les 3 plus éminents conseillers de Pharaon1. C’est aussi par la suite, à Midyane, que Moïse a trouvé refuge lorsqu’il s’échappa de cette Egypte esclavagiste, c’est encore à Midyane qu’il s’est marié et c’est, encore, de Midyane qu’était issue toute sa belle-famille.
La péricope traite des dispositions à prendre dans le cas d’une guerre dite « milhémeth mitsva »2 c’est-à-dire une guerre motivée par une raison grave telle que rétablir la sainteté de D à la différence d’une guerre ordinaire qui est différenciée en hébreu par une appellation différente : « milhémeth reshouth ». Les dispositions sont différentes sur le plan logistique : en effet, les guerriers d’Israël peuvent être dispensés de guerroyer s’ils se sont mariés récemment, s’ils ont construit une maison et n’ont pas eu encore le temps d’en profiter ou s’ils ont planté une vigne et n’en ont pas encore goûté le produit ou tout simplement s’ils sont effrayés par l’idée de la guerre.
En revanche, pour la milhémeth mitsva, chaque tribu doit envoyer au minimum 1,000 hommes. Les commentateurs se posent la question de savoir qui et combien sont partis faire la guerre contre Midyane. Les uns avancent le nombre de 12,000 soldats (12 tribus à raison de 1,000 hommes pour chaque tribu). D’autres pensent qu’ils étaient 24,000 et d’autres encore penchent pour le nombre de 36,000 ! Cependant que « l’Etat-Major » constitué de Moïse, et de Josué (Yéhoshoua bin Noun) priait pour la réussite des Bené Israël.
Lors de la guerre contre Amalek, au sortir d’Egypte, Moïse étendait ses bras, la victoire était attribuée à Israël et dès qu’il « fatiguait », les Amalécites prenaient le dessus, Aharon et Hour avaient pris place sous les bras de Moïse pour soutenir les bras du prophète. Mais, à présent, Aharon et Hour étaient morts, Moïse demanda à celui qui lui succèderait de prier avec lui.
Le Midrash nous apprend que HaShem avait reproché à Moïse de n’avoir pas eu une position très tranchée lors de l’épisode de Zimri et Cosbi tout comme il avait défendu le peuple malgré la faute du veau d’or. Moshe savait que cette guerre serait la dernière qui aurait lieu de son vivant car, D le lui avait signifié : il devrait rejoindre ses pères juste après cette guerre. Ceci provoqua, parmi les deux tribus de Lévy et d’Ephraïm quelques troubles : l’une comme l’autre ne voulait pas montrer d’empressement à cause de la mort prochaine de Moïse. D’autre part, La tribu de Lévy comportait 23,000 hommes en enlevant 1,000 il n’en restait plus que 22,000 ! Or, la Tradition précise que la Shekhina (Présence divine) ne repose sur terre qu’en présence de 22,000 hommes craignant D, se basant en cela sur ce que rapporte le Zohar : au moment de la Révélation sur le Mont Sinaï, HaShem descendit sur la montagne avec un char mené par 22,000 anges et, chacun des anges avait son ‘’répondant » sur Terre. Donc, seulement 1,000 Lévy se sont rendus au combat pendant que 1,000 autres priaient avec Moïse.
Pourquoi cette guerre ? A cause des Midyanites qui ont voulu créer une trop grande proximité avec les Bené Israël et ont aidé les Moabites en cela. Nous apprenons, en effet, que, lorsque Jacob est « descendu » en Egypte, il s’installa dans le pays de Goshen qui fut en quelque sorte, le premier ghetto de l’histoire et les enfants de Jacob ont conservé leur langue, leurs noms, leur mode vestimentaire et ne se sont pas mêlés à la population égyptienne.
En revanche, dès qu’ils sont sortis de leur ghetto, l’assimilation a débuté et avec elle, l’esclavage. Les Bené Israël sont sortis du campement et sont allés festoyer, boire et manger avec les Midyanites ; c’est pourquoi, Pinhas a voulu venger la mémoire de Joseph son arrière-grand-père. Car Joseph s’était gardé de contacts « privés » avec la femme de Putifar.
La réaction de Pinhas ne se fit pas attendre. Les Midyanites avaient voulu profaner le peuple juif en le faisant céder à des interdits et c’est pourquoi Moïse présente cette guerre comme venger le nom divin alors que D présente cette guerre comme la vengeance des Bené Israël. Or, c’est contre la Torah et D que les Midyanites voulaient s’insurger et pas contre le peuple lui-même sinon contre le fait de son allégeance en un D Unique.
Dans certains cantiques, on rappelle les ennemis d’Israël mais, il n’empêche que le nom de Midyane n’apparaît pas expressément. En s’appuyant sur le psaume 136, un verset parle de tous les ennemis d’Israël : « qui a frappé de grands rois …. Et qui a tué des rois puissants.. » Midyane est inclus parmi ces « grands rois » ou parmi les « rois puissants » mais, Og et Sihon l’étaient encore davantage.
HaShem précise au prophète qu’après la victoire sur le peuple ennemi, Moïse rejoindrait ses pères et pourtant, il s’est empressé d’exécuter l’ordre divin alors qu’il aurait pu trouver des prétextes pour tergiverser et voir ainsi ses jours se prolonger, remarque Rashi.
Contrairement à la guerre contre Amalek, Moïse ne se tint pas sur le front car, déjà, au cours des dix plaies, D avait ordonné à Moïse de ne pas frapper le fleuve ni la poussière car il ne faut jamais être ingrat et, il lui fallait se souvenir du fait que les eaux du fleuve portèrent le berceau de Moïse vers la princesse d’Egypte qui le sauva ! Dans le cas de la guerre contre les Midyanites, Moïse ne pouvait décemment pas non plus mener la guerre contre ce peuple qui l’avait reçu lorsqu’il s’était enfui d’Egypte, contre le peuple auquel appartenait sa femme et sa famille….
La parashah de Mass’é commence par l’énumération des nombreuses étapes qu’ont franchies les bné Israël depuis l’Egypte jusqu’à leur entrée en Israël pour nous montrer qu’en réalité, s’ils n’avaient pas commis de fautes et suscité le courroux divin, ils auraient pu toucher au but du voyage en onze jours au lieu d’errer pendant 40 années. En fait il y eut certaines étapes, où les Bené Israël ont séjourné de nombreuses années comme ce fut le cas à Kadesh Barnéâ.
Le nom de chacune de ces étapes indique l’épreuve qui guetta le peuple comme par exemple : « kivroth hataava » à cet endroit le peuple s’étant plaint de ne pas avoir de viande, D fit « pleuvoir » des cailles jusqu’à ce que plus que rassasiés certains y ont trouvé leur mort : kivrot du mot kever = tombeau et taava (téavon appétit) = concupiscence.
En dénombrant ces stations (42), le Shlah HaKadosh opère un rapprochement entre ce nombre d’étapes et l’un des noms sacrés de D qui comporte 42 lettres ainsi que cela est exposé dans la supplique Ana bekoah dans lequel on invoque la clémence divine pour que l’Eternel de Sa main droite (clémence = midat harahamim) nous sauve et nous pardonne nos péchés et que la clémence subordonne la justice (midat hadin)3.
Aharon le Prêtre va se préparer avec l’aide de son frère à « rejoindre ses pères ». C’est le 1er Av. Moïse alors, prend conscience qu’il est resté seul de sa fratrie après que Myriam et Aharon soient décédés.
C’est à propos du verset 53 du chapitre 33 que nos Sages ont défini en quelque sorte les règles premières du « yishouv haaretz » c’est-à-dire de la façon dont nous devons « peupler » ce pays où D habite.
1 – Trois éminents conseillers se trouvaient à la cour pharaonique lorsque Moïse était un tout jeune enfant ; il s’agit de Yithro, Bile’âm et de Job.
2 – Ou guerre idéologique en opposition à une guerre politique.
3 – Au cours de la âmida on joint les mains en apposant la main droite sur la main gauche pour que D nous juge en faisant prévaloir la clémence sur la justice.